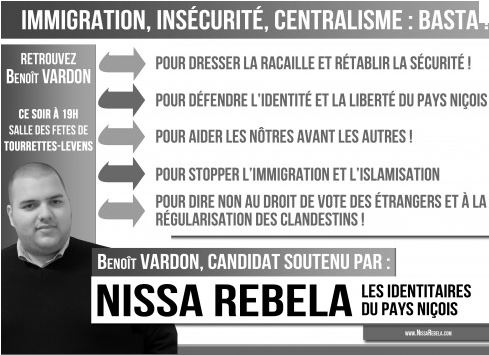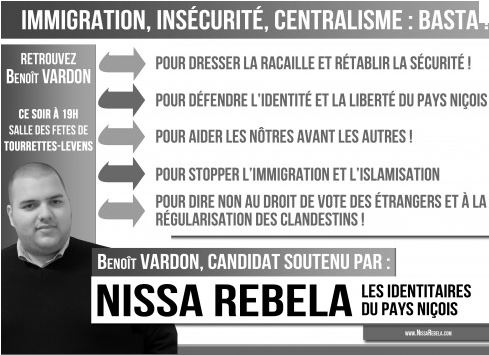« Allô ? François Hollande ? » Ce numéro-là n’a pas pu échapper aux grandes oreilles américaines de la NSA. Des dizaines de journalistes le conservent précieusement dans leur répertoire : 06 32 … … … C’est la fameuse ligne directe de sa »vie d’avant » que le président maintient malgré les mises en garde de son entourage. Quoi de plus pratique ? L’iPhone en poche, Hollande garde le contact avec ses fidèles…
Et surtout avec ses chers amis de la presse écrite et audiovisuelle ! En cas de besoin, les chroniqueurs du hollandisme, petits et grands, peuvent toujours lui adresser un texto. « En général, il répond et fixe un rendez-vous téléphonique. Discuter une demi-heure avec le président avant de pondre son papier, il n’y a pas mieux », décrypte une habituée chargée de couvrir l’Elysée :
Je préfère parler au bon Dieu qu’à ses saints. »

Porteurs de micros et plumitifs
Ah, les journalistes ! Les espions de la NSA savent sans doute que notre président de la République les adore. En pleine crise diplomatique, il trouve le temps de les prendre au téléphone pour de piquants décryptages du congrès socialiste. Sous le joug du protocole, il leur donne rendez-vous pour une discrète conversation en off. Sans se soucier du jet lag, il les débriefe dans son avion. Au plus bas dans les sondages, il les reçoit à déjeuner à l’Elysée.
Et même quand il les prend en flagrant délit de »Hollande bashing », il se garde bien de leur adresser le moindre reproche. A la différence notable de Nicolas Sarkozy qui prétendait dominer une presse dont il se méfiait, la passion de François Hollande pour les porteurs de micros et les plumitifs n’a jamais cessé. Et ne cessera jamais.
« C’est comme s’il s’était promis d’inverser sa courbe de popularité dans les rédactions, explique un chroniqueur politique. Il procède par série : il a invité à déjeuner les rédactions de BFM TV, iTélé, LCI-TF1… » Et même récemment celle de »l’Obs ». Qui n’a pas cassé la croûte avec le président depuis 2012 ? Après l’attentat contre »Charlie Hebdo », on apprenait que Hollande avait reçu à sa table l’équipe du regretté Charb quelques semaines avant la tragédie, pour parler des finances du journal.
Avant de lancer son nouveau quinzomadaire branché, la bande de »Society » a été, elle aussi, reçue à la table présidentielle. Au dessert, le président lui a lui-même soumis l’idée d’un grand entretien : en mars, »Hollande, la grande confession » a fait la couverture. Le président est accessible ! Maïtena Biraben, l’a bien compris. » Je lui ai écrit un texto : ‘Si vous voulez voir des Français, il y en a chez moi, venez dîner' », a-t-elle raconté à « Télé-Obs », avant de soutenir que ces agapes – François a rendu l’invitation ! – n’avaient aucun lien avec la participation de Hollande à son émission, en avril dernier : une interview de deux heures suivies par 1,7 million de Français…
Vive le story telling !
Hollande sait se montrer prévenant. Il s’enquiert de la carrière de l’un, interroge l’autre sur les audiences de son émission et suggère à tous des idées de papiers ou de reportages. Que distille-il entre la poire et le fromage ? »Que la prochaine présidentielle se jouera autour du thème de l’identité. Et qu’il faudra rassembler et réunir les Français », confie un journaliste invité. Le président est assez subtil pour ne pas évoquer directement sa candidature. Et pourtant télés, radios et gazettes ont largement propagé la nouvelle : François Hollande ne pense plus qu’à 2017 et repart à la conquête des Français ! Des »éléments de langage » et un programme de déplacements communiqués aux journalistes par les conseillers du Château… Histoire de bien montrer que le sortant sera le candidat naturel de la gauche et n’a pas vocation à se soumettre à une quelconque primaire. Vive le story telling !
Même au creux de la vague, le premier journaliste de France sait qu’il peut compter sur la presse. L’idylle remonte à ses débuts en politique. Chef de cabinet de Max Gallo, porte-parole de l’Elysée sous Mitterrand, il noue alors des relations avec des pros qui sont aujourd’hui encore ses interlocuteurs. Hollande, le jeune prof à Sciences Po, fournit même des chroniques économiques au »Matin », quotidien de gauche repris en main par le clan mitterrandiste. Comme porte-parole du parti socialiste puis premier secrétaire, il passe pour un excellent client : toujours la petite phrase qui convient, l’anecdote percutante dont raffolent les magazines, l’analyse politique qui bluffe les »rubricards » ou l’écho qui vient alimenter les pages de confidentiels. Un spécialiste des arcanes socialistes se souvient :
Hollande était très proche de Jospin qui ne parlait pas aux journalistes. Du coup, il est devenu la meilleure source de Paris. »
Et comme François a le don de faire rire la galerie, les reporters s’amusent tout en s’informant. »François a toujours aimé travailler avec un petit clan de journalistes », nous confirmera Ségolène Royal, quelques années plus tard. En 2005, Hollande est si confiant, qu’il pose aux côtés de Nicolas Sarkozy pour une couverture de »Paris Match » en défense du traité constitutionnel européen… Une faute politique.

Traversée du désert
Après son départ du poste de premier secrétaire, en 2008, Valérie Trierweiler, sa »journaliste préférée », l’aide à traverser le désert. Mais les confrères reviennent vite sous l’oeil courroucé de la dame. Strauss-Kahn est tombé, du coup, Hollande bénéficie d’une excellente presse auprès de tous les déçus du sarkozysme et des orphelins de DSK. Aubry, c’est bien connu, déteste les journaleux, à de rares exceptions près…
Sur le »Hollande Tour », notre consoeur belge Charline Vanhoenacker s’étonne ironiquement de la connivence entretenue avec les reporters à coups de petites récompenses (quelques minutes avec le candidat !) ou de brimades (exclusion du pool). Son papier « Ces journalistes qui se voient déjà à l’Elysée » fait scandale dans le bus des suiveurs. Hollande, lui, s’en amuse… Et au lendemain de la victoire, Manuel Valls, son efficace conseiller en communication, lui organise même un pot de l’amitié, au siège de campagne, rassemblant ceux appelés à couvrir ses prochaines aventures élyséennes. »Vous allez me manquer », lance le nouveau président.
Le journaliste « lèche, lâche puis lynche »
Hollande sait déjà qu’il ne bénéficiera d’aucun état de grâce. A l’instar de son ami Jean-François Kahn, le président n’a pas oublié que le journaliste « lèche, lâche puis lynche ». Franz-Olivier Giesbert, le patron du »Point », qui connaît et apprécie Hollande depuis des lustres, lui fait vite comprendre lors d’un déjeuner à l’Elysée que l’ère du « Hollande bashing » est ouverte ! L’hebdo de centre-droit est le premier à tirer sur le président normal, devinant qu’il ne pourra pas tenir ses promesses… La multiplication des couacs gouvernementaux et l’engagement »d’inverser la courbe du chômage » ne font qu’élargir le fossé entre François Hollande, les médias et l’opinion. Le président a beau multiplier les émissions de télé pour expliquer ses réformes, il n’imprime pas. Trop techno et emprunté, l’animal n’est pas à l’aise devant la caméra. Il préfère de loin les discussions de vive voix ou les estrades des meetings.
Une présidence normale
Pour ne rien arranger, le nouvel élu se met en tête de casser les codes. »En arrivant, il a voulu imposer un style nouveau, celui d’une présidence normale. Mais il n’occupait pas l’espace présidentiel. Les Français ne l’ont pas compris », analyse le politologue Stéphane Rozès. Et quel bazar dans son cabinet ! Quatre conseillers se disputent le dossier stratégique de la communication. L’ancien journaliste Claude Sérillon, appelé à la rescousse pour veiller sur l’image, n’a pas d’attributions définies. Et reçoit pour consigne absurde de ne pas parler aux journalistes…
Profitant du maelström qu’il a lui-même créé, le président n’en fait plus qu’à sa tête. En octobre 2013, au grand dam de son équipe, c’est lui qui décide, tout à trac, de signifier par une allocution télévisée à la jeune Leonarda, collégienne sans papiers reconduite à la frontière, qu’elle peut revenir en France… »C’est mort ! », lui rétorque l’ado, en direct, sur BFM TV. Un désastre de communication. »Hollande, qui n’était pas rassuré par Ayrault, s’occupait de tout. Et communiquait sur des affaires qui n’étaient pas de son niveau », explique un ex du staff élyséen.
Et puis il y a cette satanée vie privée. Hollande, ce grand cachottier, déteste mettre en scène son intimité… En janvier 2014, la révélation par »Closer » de sa liaison avec la comédienne Julie Gayet le tourne en ridicule devant la planète entière. Claquemuré, le président officialise sa rupture par une conversation téléphonique avec la journaliste Sylvie Maligorne, une vieille connaissance alors chef du service politique de l’AFP. Du pur Hollande…

Pour sortir de la nasse, le président profite de l’arrivée à Matignon de Manuel Valls. Son ancien conseiller en communication s’emploie – entre autres – à recadrer la com gouvernementale désormais clairement hiérarchisée et cadrée. En avril 2014, la démission d’Aquilino Morelle, conseiller politique et responsable de la communication élyséenne visé par une enquête de Mediapart sur son train de vie et ses accointances avec un labo pharmaceutique, fournit au président l’occasion de professionnaliser sa com.
Morelle est remplacé par Gaspard Gantzer, ancien condisciple d’Emmanuel Macron à l’ENA et ex-conseiller de Bertrand Delanoë et de Laurent Fabius. Le jeune homme aux allures de dandy, direct et efficace, a l’avantage de ne pas connaître Hollande et de se voir confier une claire responsabilité : devenir le principal interlocuteur des journalistes. Il confie :
La plupart d’entre eux ont vite compris qu’il valait mieux passer par moi. Mais, moi, j’ai vite compris que les plus anciens ou ceux qui le connaissent le mieux continueraient à l’appeler directement.
« Merci pour ce moment »
Le ciel médiatique ne s’éclaircit pas pour autant. En mars 2014, la sortie de »Merci pour ce moment », le best-seller de Valérie Trierweiler, est un nouveau coup de tonnerre. Qui laisse le président, accusé de mépriser les »sans-dents » sans voix… En vérité, il aurait pu poursuivre sur cette trajectoire incertaine s’il n’y avait eu un événement cathartique : l’irruption de la tragédie. En janvier, les attentats changent tout. Et le contraignent à hausser son jeu. Face à la barbarie qui a frappé »Charlie » puis l’Hypercacher, l’ex-président du Conseil général de la Corrèze finit par endosser le costume.
Sa première allocution solennelle, le 7 janvier, prononcée en direct devant 21 millions de téléspectateurs est l’acte de naissance du Hollande régalien, ce monarque républicain qui prétend protéger et rassembler. Ses proches n’en croient pas leurs yeux : même Angela Merkel pose la tête contre son épaule dans un cliché qui fera date ! La séquence, parfaitement maîtrisée jusqu’à la manifestation du 11 janvier, mettant en scène réunions de crise et prises de parole martiales, sert de modèle depuis six mois.
Un nouveau soin est apporté à toutes ses apparitions. »Le président est maître de sa communication. Et il a des idées très claires sur le sujet », précise Gaspard Gantzer. Méfiant à l’égard des gourous de la com politique, Hollande, le secret, ne s’est jamais attaché les conseils des pros et garde une dent contre Stéphane Fouks (Havas Worldwide), qu’il accuse d’avoir fait sombrer Jospin en 2002.Gantzer précise :
A ses yeux, la communication est une technique comme une autre. Mais ce n’est pas une pensée magique.
« Proximité » et « présidentialité »
Info en continu, mondialisation de l’image et règne du buzz… Hollande, tellement enclin à s’inspirer de François Mitterrand, considère que le monde médiatique a changé depuis l’époque où Jacques Pilhan, le »sorcier de l’Elysée », théorisait la rareté de la parole du président jupitérien. »On peut être président tout en restant proche, honnête et accessible », répète-t-on à l’Elysée où l’on a appris à cultiver deux vertus cardinales : la »proximité » et la »présidentialité ».
C’est à cette aune que doit être analysée, par exemple, l’introduction de la chienne Philae, charmant labrador qui présente l’avantage d’être un attribut du souverain… Et une preuve de son humanité ! Très présent sur les réseaux sociaux, Gantzer prône la réactivité : il ne faut pas laisser circuler ce qui pourrait amoindrir la légitimité du chef de l’Etat. Une équipe veille sur sa cyber réputation.
Pour accroître ses chances en 2017, Hollande soigne aussi ses relations avec les patrons des médias. Lui, président, n’avait-il pas juré de ne pas se mêler des nominations dans l’audiovisuel public ? Dont acte. Sous la houlette de son ami Olivier Schrameck, ancien dircab de Jospin, le CSA a donné des gages d’indépendance. Mathieu Gallet, marqué à droite, a été bombardé à la tête de Radio France. Et Delphine Ernotte, ex-dirigeante d’Orange, propulsée aux commandes de France Télévisions.
Mais cela n’a pas empêché le président et son premier cercle de suivre de près le processus. La nomination d’Ernotte, en particulier, n’aurait jamais été possible sans l’appui résolu d’un réseau très actif : le président du CSA, la ministre de la Culture Fleur Pellerin, l’ex-conseiller du président David Kessler et le conseiller en communication Denis Pingaud ayant tous leurs entrées à l’Elysée… Il apparaît clairement que les nouveaux patrons des antennes publiques doivent beaucoup au pouvoir en place. Et l’on voit mal comment ces puissants relais pourraient lui faire défaut d’ici à la fin du quinquennat.

Du côté du privé, le virage social libéral rassure. Les grands patrons qui dominent le paysage médiatique n’ont désormais plus guère de raison de se plaindre. Les relations sont au beau fixe avec Serge Dassault, le patron du »Figaro », qui ne tarit pas d’éloge sur un gouvernement qui lui a permis de caser 60 Rafales jusqu’alors réputés invendables. Le courant passe avec Martin Bouygues, propriétaire de TF1, qui rencontre souvent Hollande et cherche son appui. Idem pour Vincent Bolloré, aux manettes de Canal+, qui semble désireux de refréner les ardeurs persifleuses des Guignols de l’info dont la réplique de Hollande en latex – un benêt boulimique soumis aux caprices de ses femmes – désespère l’Elysée…
A l’affût, le groupe Lagardère, lui, a dépêché ses meilleurs émissaires : en avril dernier, François Hollande a été vu dans un restaurant chic parisien attablé avec Jean-Pierre Elkabbach (Europe 1) et Ramzi Khiroun (porte-parole du groupe). Avec Xavier Niel (Free), Matthieu Pigasse (banque Lazard) et Pierre Bergé (Fondation Saint-Laurent), les copropriétaires du »Monde », de »l’Obs » et de »Télérama », le président socialiste se trouve face à des investisseurs qui ont choisi de développer un pôle de presse de sensibilité sociale-démocrate. Quant à Patrick Drahi, patron de SFR Numéricâble et nouveau propriétaire de »l’Express » et de »Libé », il a opté pour le retour de Laurent Joffrin, un ami assumé du président, à la tête du quotidien… Seule ombre au tableau : la montée en puissance de Bernard Arnault. Proche de Nicolas Sarkozy, le patron de LVMH, déjà propriétaire des »Echos », vient de s’offrir « le Parisien ». Un quotidien de proximité que François Hollande a placé au coeur de sa stratégie de reconquête de l’électorat populaire. Alors à quand un déjeuner avec Arnault ? La bataille de 2017 sera médiatique et calorique !
Par Sylvain Courage